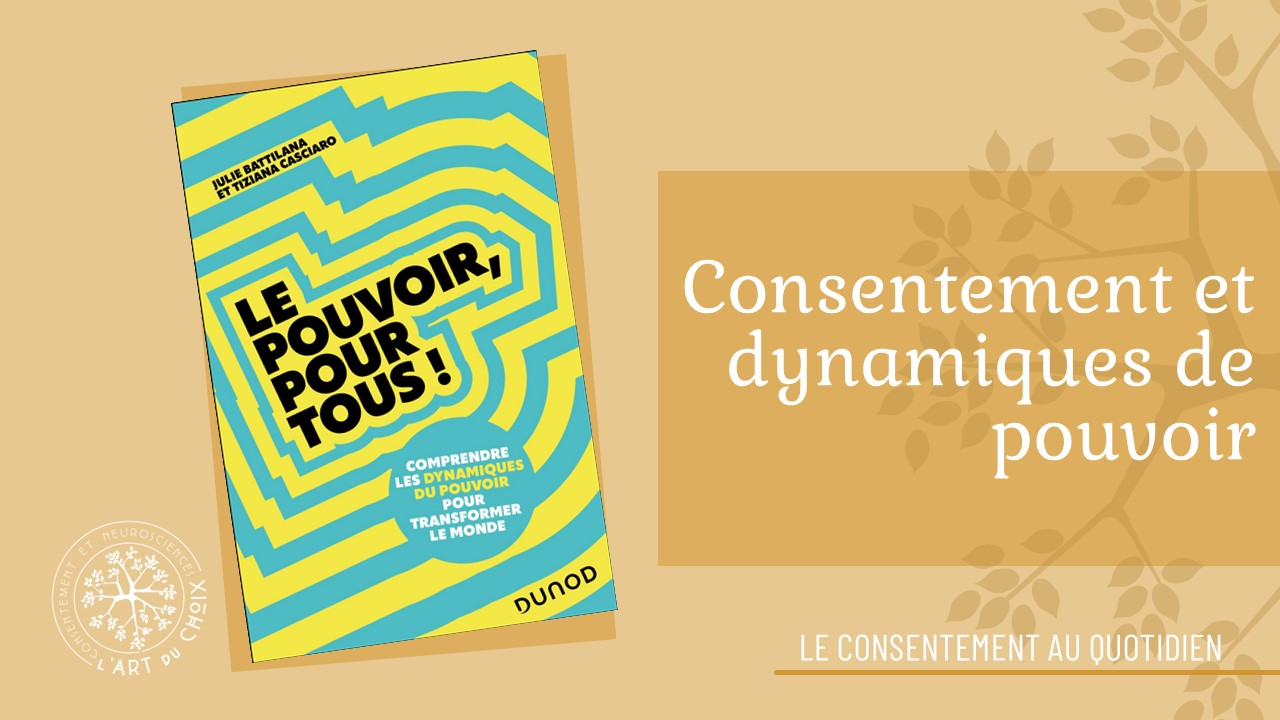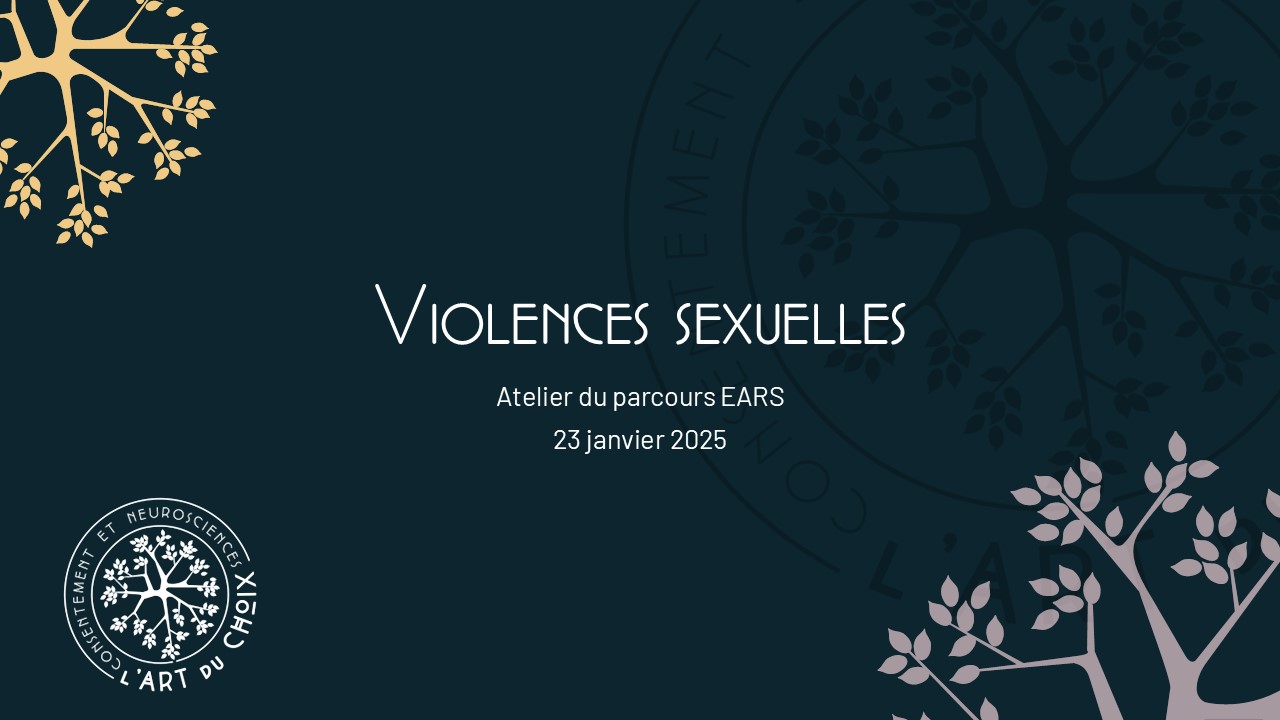Stress et consentement : comprendre les mécanismes de défense pour mieux agir
Pourquoi le stress complique le consentement… une question de sécurité
Le consentement est un pilier des relations équilibrées et respectueuses.
Pourtant, dans certaines situations, il devient difficile, voire impossible, de créer un accord clair fondé sur un consentement éclairé.
Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes en état de stress, notre cerveau active des mécanismes de défense qui court-circuitent nos capacités de réflexion et de communication. Comprendre ces processus, notamment à travers la Generalized Unsafety Theory of Stress (GUTS) ou à la théorie polyvagale, permet d’identifier les obstacles au consentement et de créer des environnements propices à des interactions authentiques.
Faisons aujourd’hui un focus sur la GUTS !
I. La théorie GUTS : une nouvelle perspective sur le stress et la sécurité
La Generalized Unsafety Theory of Stress (GUTS), développée par Brosschot, Verkuil et Thayer, repose sur une idée clé : le stress n’est pas toujours une réponse à un événement stressant.
En réalité, notre réponse au stress est activée par défaut et ne se désactive que si le cerveau perçoit des signaux clairs de sécurité.
En l’absence de ces signaux, le cerveau considère automatiquement que l’environnement est potentiellement dangereux, ce qui maintient le système en état d’alerte.
Cette approche diffère des théories classiques, qui associent le stress à des stimuli externes (comme un danger imminent, ou une menace plus émotionnelle ou relationnelle). GUTS montre que des contextes apparemment neutres peuvent entraîner un stress chronique s’ils ne fournissent pas suffisamment d’indications de sécurité.
Cela inclut des situations de solitude, de fatigue, ou encore des environnements perçus comme incertains ou imprévisibles.
Le monde moderne est décrit par un nouvel acronyme BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible), qui traduit littéralement Fragile, Anxieux, Non-linéaire et Incompréhensible… Un contexte « parfait » pour se sentir par défaut en insécurité.
II. Les mécanismes de défense activés par le stress
Lorsque le stress devient chronique ou intense, le cerveau mobilise des mécanismes de défense, des réponses automatiques conçues pour assurer notre survie immédiate :
- La fuite ou l’évitement : l’individu cherche à s’éloigner physiquement ou mentalement de la situation.
- L’attaque ou l’agressivité : une réponse impulsive pour reprendre le contrôle perçu.
- La dissociation : un détachement émotionnel qui protège l’esprit face à une situation perçue comme insurmontable.
Ces mécanismes, bien que bien adaptés dans des contextes de danger immédiat, limitent notre capacité à nous connecter à nos émotions, à réfléchir clairement et, par conséquent, à exprimer ou à entendre un consentement libre et éclairé.
Dans les textes d’étude du trauma et de ces conséquences sur les comportements des individus, d’autres réponses sont décrites (apaisement, faire ami-ami, etc) qui montrent l’étendue des réponses, plus ou moins fonctionnelles, que l’on déploie sous stress. Ici, on s’en tient au contenu de l’article publié par les chercheurs sur GUTS.
III. Les implications pour le consentement
Le consentement repose sur la capacité de chacun à poser des limites, à écouter ses besoins et à communiquer de manière authentique.
Or, le stress altère ces fonctions. Les mécanismes de défense empêchent non seulement l’expression d’un choix clair, mais aussi sa réception par autrui.
En d’autres termes, sans un environnement de sécurité, le consentement ne peut être véritablement reconnu.
Vers des espaces de sécurité pour un consentement authentique
En s’appuyant sur la théorie GUTS, on comprend pourquoi, pour favoriser des relations équilibrées, il faut d’abord créer des contextes où la sécurité est perceptible et perçue. Cela passe par une meilleure compréhension des mécanismes du stress, une sensibilisation à l’importance des signaux de sécurité (sociaux, émotionnels, environnementaux) et un travail collectif pour réduire les facteurs de stress.
Par exemple, comment ai-je tendance à réagir quand on me dit non ? ai-je tendance à juger des comportements à haute voix ? ai-je tendance à insister, tenter de convaincre au point de mettre la personne mal à l’aise ? Est-ce que je force à sourire mais que tout mon corps et mon esprit sont tendus vers la recherche d’une solution pour, quand même, faire dire oui, pour, quand même, obtenir ce que je veux. Le système nerveux de la personne en face perçoit ces tensions le système nerveux et, même inconsciemment, son système se met en défense. Selon le mécanisme le plus habituel, intervient une dispute, un long échange d’argumentation, ou une résolution rapide, car l’autre cède…
Le consentement, c’est aussi faire sa propre revue de comportements pour voir dans quelle mesure nous contribuons à mettre à l’autre à l’aise, pour lui laisser une chance de s’exprimer honnêtement.
Cela nous laisse alors une chance de nous rencontrer vraiment.
En fin de compte, éduquer sur ces dynamiques ne consiste pas seulement à lutter contre les situations d’insécurité. Cela permet aussi d’encourager des relations basées sur la clarté, la confiance et l’équilibre. Que chacun perçoive que l’autre lui veut du bien.
Lire l’article source sur GUTS
Lire un article complet sur GUTS : Generalized Unsafety Theory of Stress: Unsafe Environments and Conditions, and the Default Stress Response by Jos F. Brosschot, Bart Verkuil and Julian F. Thayer